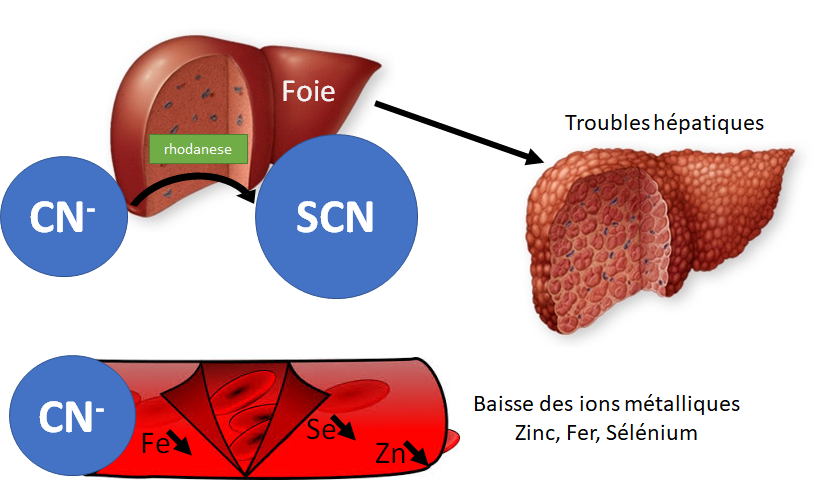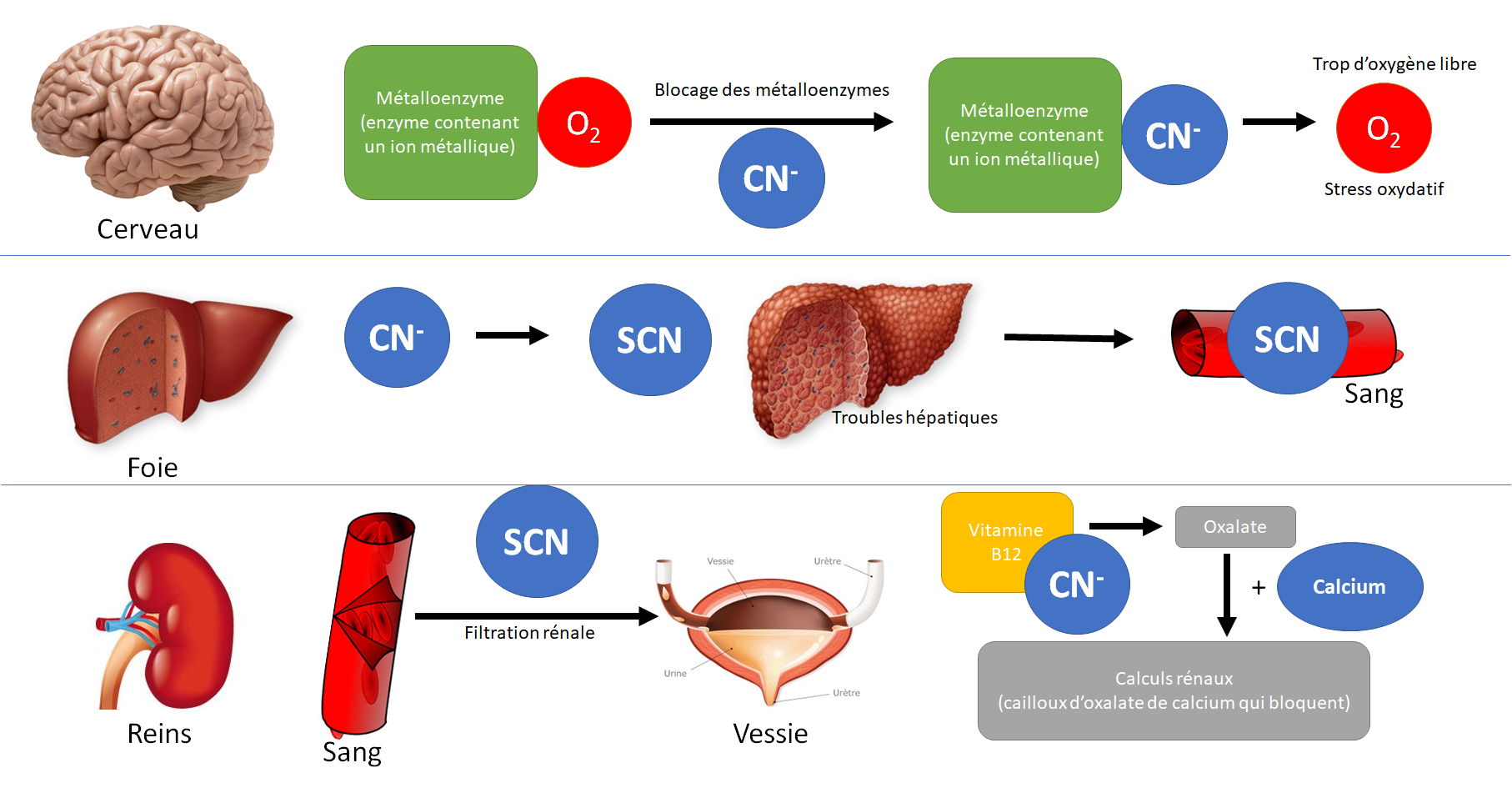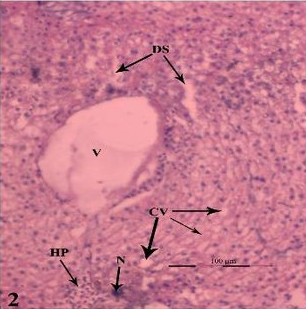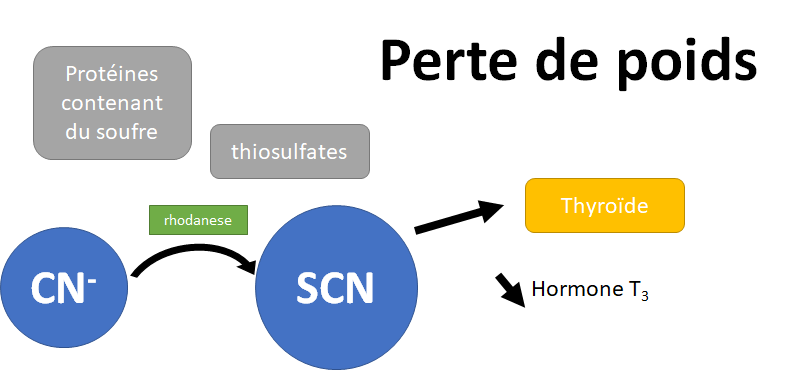Lien vers l’article
Près de 5000 grenades lacrymogènes ont été utilisées samedi à Paris. La Convention de 1993 interdit l’utilisation des gaz lacrymogènes en tant que «moyen de guerre», mais les autorise pour le maintien de l’ordre intérieur.
Question posée par le 25/11/2018
Bonjour,
Nous avons reformulé votre question initiale : «Une personne a partagé sur Facebook une photo de la célèbre page «Le saviez-vous ?». Cette dernière affirme que l’utilisation de gaz lacrymogène et de toutes autres grenades anti-émeutes est interdite par la Convention de 1993 portant sur l’utilisation des armes chimiques en période de guerre. Est-ce vrai ? Car mes recherches sur la question n’ont rien donné!»
Alors que le préfet de police a affirmé ce matin que 5000 grenades lacrymogènes avaient été utilisées samedi à Paris par les forces de l’ordre, vous souhaitez vérifier l’affirmation suivante: «Le gaz lacrymogène et les autres agents antiémeutes sont considérés comme des armes chimiques et sont interdits dans la guerre par la Convention de 1993», que relaie la page Facebook «Le saviez-vous».
La «Convention de 1993», citée par la page Facebook, correspond à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Elle a été ouverte à la signature à Paris en 1993, est entrée en vigueur en avril 1997, et a été ratifiée jusqu’aujourd’hui par 193 pays.
Les gaz lacrymogènes interdits pour faire la guerre
Cette convention indique dans son article I (5) que «chaque Etat partie s’engage à ne pas employer d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre» et définit dans son article II (7) ces agents de lutte antiémeute comme étant «tout produit chimique qui n’est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu’a cessé l’exposition».
Ce descriptif correspond bien à l’idée qu’on se fait d’une grenade ou d’un spray lacrymogène et c’est aussi ainsi que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OPCW) les catégorise sur son site anglais, lorsqu’elle note que «les agents antiémeutes, comme les gaz lacrymogènes, sont considérés comme des armes chimiques s’ils sont utilisés comme méthode de guerre». On comprend donc que la Convention de 1993 interdit bien l’usage des gaz lacrymogènes lors de conflits entre pays.
Autorisés pour maintenir l’ordre intérieur
Cependant dans le même texte, l’OPCW note également que «les États peuvent légitimement posséder des agents antiémeutes et les utiliser à des fins de maintien de l’ordre, mais les États qui sont membres de la Convention sur les armes chimiques doivent déclarer le type d’agents antiémeutes qu’ils possèdent». Cette exception correspond à l’article II (9.d) qui précise que parmi «les fins non interdites par la présente Convention», on trouve les «fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur».
Comment expliquer ce paradoxe, qui interdit ces armes lacrymogènes pour faire la guerre à autrui, mais les autorise pour mater les révoltes intérieures? Interrogé par le magazine de gauche américain Jacobin, Anna Feigenbaum, autrice de «Tear Gas. From the Battlefields of World War I to the Streets of Today», explique cette contradiction par le fait que le gaz lacrymogène était utilisé durant la première guerre mondiale, ou pendant la guerre du Vietnam pour faire sortir les soldats des tranchées ou de leurs bunkers, pour ensuite les attaquer à l’aide d’armes à feu ou d’autres gaz. «Ce genre d’utilisation militaire est la raison pour laquelle cette interdiction existe en temps de guerre».
Parallèlement à cet usage militaire, la chercheuse note qu’on explore à partir des années 1920 et 1930 l’emploi des gaz lacrymogènes «pour réprimer les conflits sociaux et les grèves», ainsi que pour contrer «les soulèvements coloniaux et les mouvements indépendantistes», c’est-à-dire des conflits intérieurs. Anna Feigenbaum conclut: «l’utilisation militaire des gaz lacrymogènes et le développement d’un marché commercial des gaz lacrymogènes pour les forces de l’ordre se sont déroulés parallèlement les uns aux autres et n’étaient pas toujours liés».
Une règle paradoxale
Lors des émeutes de Ferguson (Missouri) en 2014, la question de l’usage des gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre a été soulevée par certains médias américains, dont le Washington Post. Dans un article publié par Politifact, l’organisation de fact-checking est revenue sur le paradoxe de la Convention avec plusieurs experts. Dans son article, le site américain répète que l’interdiction militaire des gaz lacrymogène est liée à la difficulté qu’ont les soldats à distinguer s’ils sont exposés à un gaz mortel ou non. Sur son usage policier, Politifact donne la parole à David Koplow, professeur de droit à l’université de Georgetown, qui considère que pour maîtriser une émeute, «même si le gaz lacrymogène est loin d’être parfait, il continue d’être utilisé à cet effet parce qu’il n’y a rien de mieux».
Hormis les charges physiques de policiers, pour disperser une foule, les forces de l’ordre utilisent des canons à eau (avec parfois des additifs lacrymogènes ou olfactifs), des pistolets à balle en caoutchouc de type flash-ball ou encore des pistoles Pepperball, qui tirent des balles de poivre (ils existent en Allemagne) ou encore des grenades à effet de souffle (une spécialité française). Mais ces armes présentent des risques de blessure physique (perte d’un œil à cause d’une balle ou d’un jet de canon, tympan perforé) qu’on n’obtient pas avec un spray lacrymogène.
En résumé: La Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques interdit l’utilisation de gaz lacrymogènes en temps de guerre, mais paradoxalement l’autorise pour maintenir l’ordre intérieur. Cette contradiction semble s’expliquer par le fait que l’interdiction militaire vise à interdire l’usage du gaz afin de faire sortir des soldats pour mieux les abattre, tandis que l’usage policier sert uniquement à disperser des personnes, sans objectif létal.Jacques Pezet